Philosophie ?

Une méthode unique !
La philosophie appliquée au management...
Au sein de Parrhèsia, nous ne séparons pas la pensée de l’action. Nous pensons le réel tel qu’il apparaît, sans le refuser ni l’idéaliser, et nous construisons des chemins pratiques pour le transformer. Heidegger rappelait que « penser, c’est s’avancer dans l’ouvert » : il ne s’agit donc pas de surplomber la réalité par des concepts, mais d’en éclairer les lignes de force.
Cette pensée, nous l’assumons comme une exigence critique. Bonhoeffer dénonçait la « crétinisation du monde » : ce règne des réponses faciles, du mimétisme et des évidences jamais interrogées. Or, en management comme ailleurs, céder à cette logique, c’est condamner l’action à tourner à vide. La philosophie est ici une manière de résister à cette superficialité, et d’exercer ce que nous appelons le discernement : voir clair, comprendre juste, décider avec lucidité.
Cette articulation est le fondement notre méthode unique : penser le réel pour mieux agir, agir pour approfondir la pensée. Ni pure spéculation, ni simple pragmatisme, mais une pratique philosophique qui fait dialoguer concepts et expériences, réflexions et décisions.
1. QUESTIONNER
« Le début de la sagesse consiste à savoir que l’on ne sait pas », rappelait Socrate. Tout commence par le courage de poser des questions, et surtout de douter des évidences. Or, dans la grande majorité des cas, la première question n’est pas (du tout !) la bonne.
Par exemple : une entreprise nous sollicite pour un cycle de formation à l’entretien annuel. L’apparence est claire : former les managers à conduire des entretiens. Mais dès que nous interrogeons — les managers savent-ils définir des objectifs ? Les missions sont-elles clarifiées et formalisées ? Les entretiens sont-ils une simple formalité administrative ou un levier stratégique ? — le besoin change de visage.
Et c’est ici que réside le point crucial : cette étape n’est pas un détour inutile, elle révèle que la « première question » n’était pas la bonne. Sans ce travail ingrat, toute solution serait artificielle. Questionner, c’est accepter le détour, l’inconfort, la remise en cause, quitte à décevoir l’attente d’une réponse immédiate. Mais c’est la seule manière de ne pas céder à la facilité : le règne des réponses « simples » qui évitent les vrais problèmes.
2. PROBLÉMATISER
Nietzsche écrivait : « penser profond, c’est soupçonner sous la réponse un autre problème ». Problématiser, consiste précisément en ce geste : aller au-delà de la demande immédiate, souvent mal formulée, pour identifier le problème réel. Ici s’ouvre le cœur philosophique de notre approche : distinguer l’essentiel du secondaire, ramener la complexité à ses lignes de force, refuser la dispersion et l’illusion des solutions rapides. Derrière la question, quel est le réel problème ?
C’est un travail exigeant car il ne se contente pas de clarifier : il déplace le centre de gravité de la réflexion. Derrière la question affichée, souvent trop étroite, surgit un enjeu plus vaste, plus vital pour l’entreprise. Cette étape est décisive : sans problématisation, on reste prisonnier des symptômes et l’on soigne la périphérie au lieu du cœur. Comme le rappelle Edgar Morin : « La complexité est à affronter, non à contourner ». Problématiser, c’est donc accepter de séjourner dans la complexité, pour en extraire une lucidité de compréhension et ouvrant sur l’action…
3. RÉPONDRE
Héraclite d'Éphèse mettait en avant cette antinomie si féconde : « ce qui est en lutte engendre l’harmonie ». Répondre, c’est précisément cela : construire une réponse singulière à partir des résistances du réel. Jamais une recette, jamais un copier-coller. Chaque organisation a son histoire, ses contradictions, ses forces : la réponse doit naître de là.
Nous revendiquons donc une approche artisanale, patiente et exigeante. Cette étape est la mise à l’épreuve de tout le chemin : si la réponse n’est pas forgée à partir de la problématisation, elle n’est qu’un protocole plaqué. Répondre, c’est construire avec nos interlocuteurs des dispositifs ajustés, élaborés pas à pas, où la pensée se fait action. La philosophie y retourne au réel, aiguisée par le questionnement et la problématisation, et devient force de transformation concrète.
Un binôme complémentaire...
Cette méthode est portée par une alliance singulière :
Jean-Olivier Allègre, philosophe praticien, nourri par des auteurs anciens (Héraclite, Socrate, Diogène), modernes (Nietzsche, Hegel, Freud, Heidegger, Bonhoeffer…) et contemporains (Marcel Conche, Edgar Morin), qui accompagnent encore son regard sur le réel.
Sophie Girard, praticienne du management, qui ramène sans cesse la pensée au concret de ce que vivent les organisations et leurs acteurs.
Notre dialogue permanent fonde notre force : penser et agir sans séparer, comprendre avant de juger, ouvrir des espaces de lucidité partagée. Et c’est ici la clef : nous n’appliquons pas une méthode sur le monde, nous entrons en dialogue avec lui. Parrhèsia est une méthode de vérité : une manière d’oser dire, questionner, problématiser et répondre, pour que les organisations avancent autrement — avec justesse, courage et discernement.
Blog
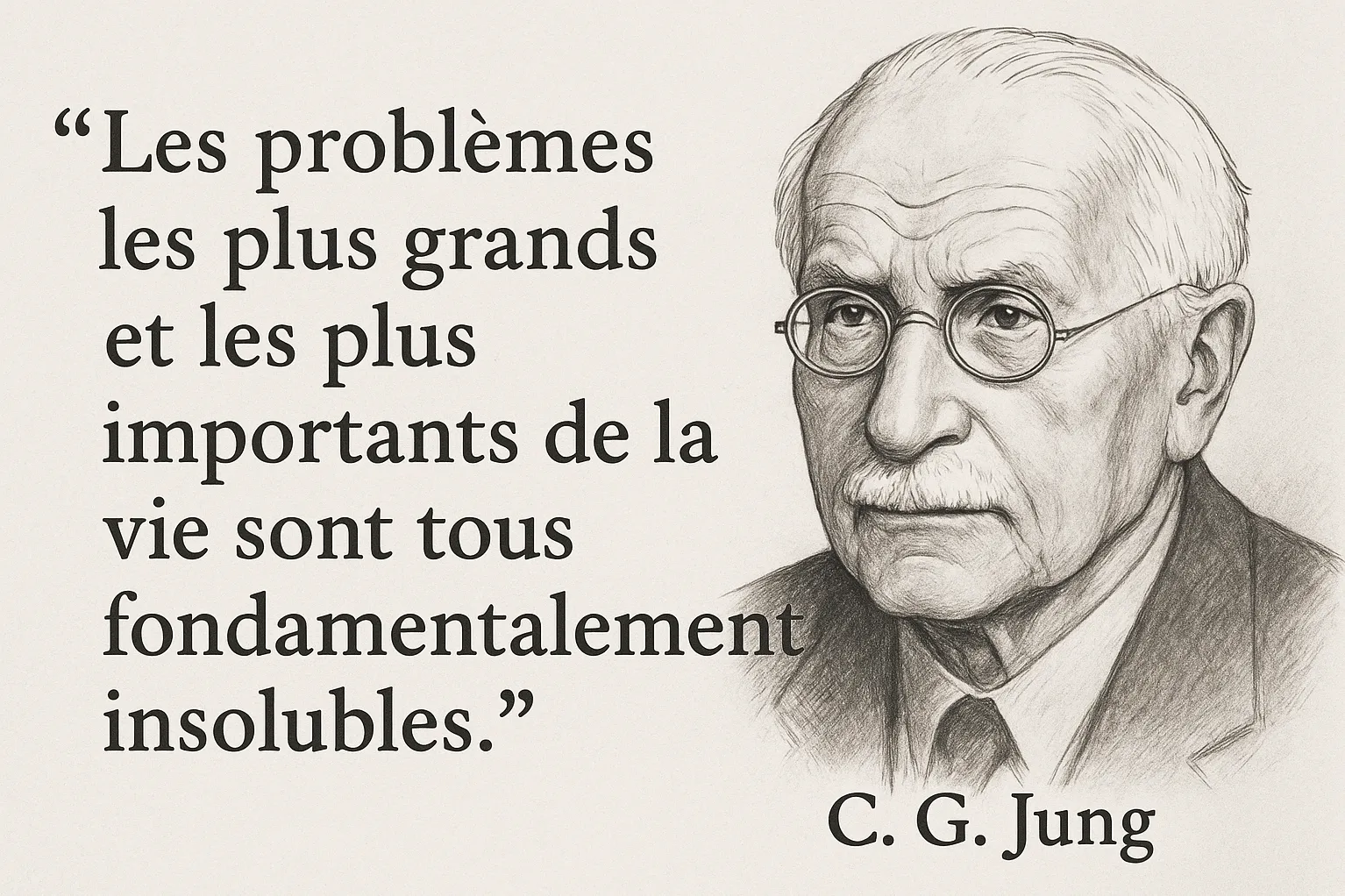
Les problèmes insolubles et la valeur de chacun
Pourquoi la complexité dérange-t-elle autant en entreprise ? Parce qu’elle ne se dissout pas dans des process, mais oblige à coopérer, à reconnaître l’humain, et à miser sur la valeur de chacun.

Conseil et formation : concours de popularité ou vérité ?
Former pour plaire, c’est flatter les acquis et entretenir l’illusion du changement. Former pour transformer, c’est oser le choc du vrai : inconfortable, mais seul capable de libérer une énergie durable.

