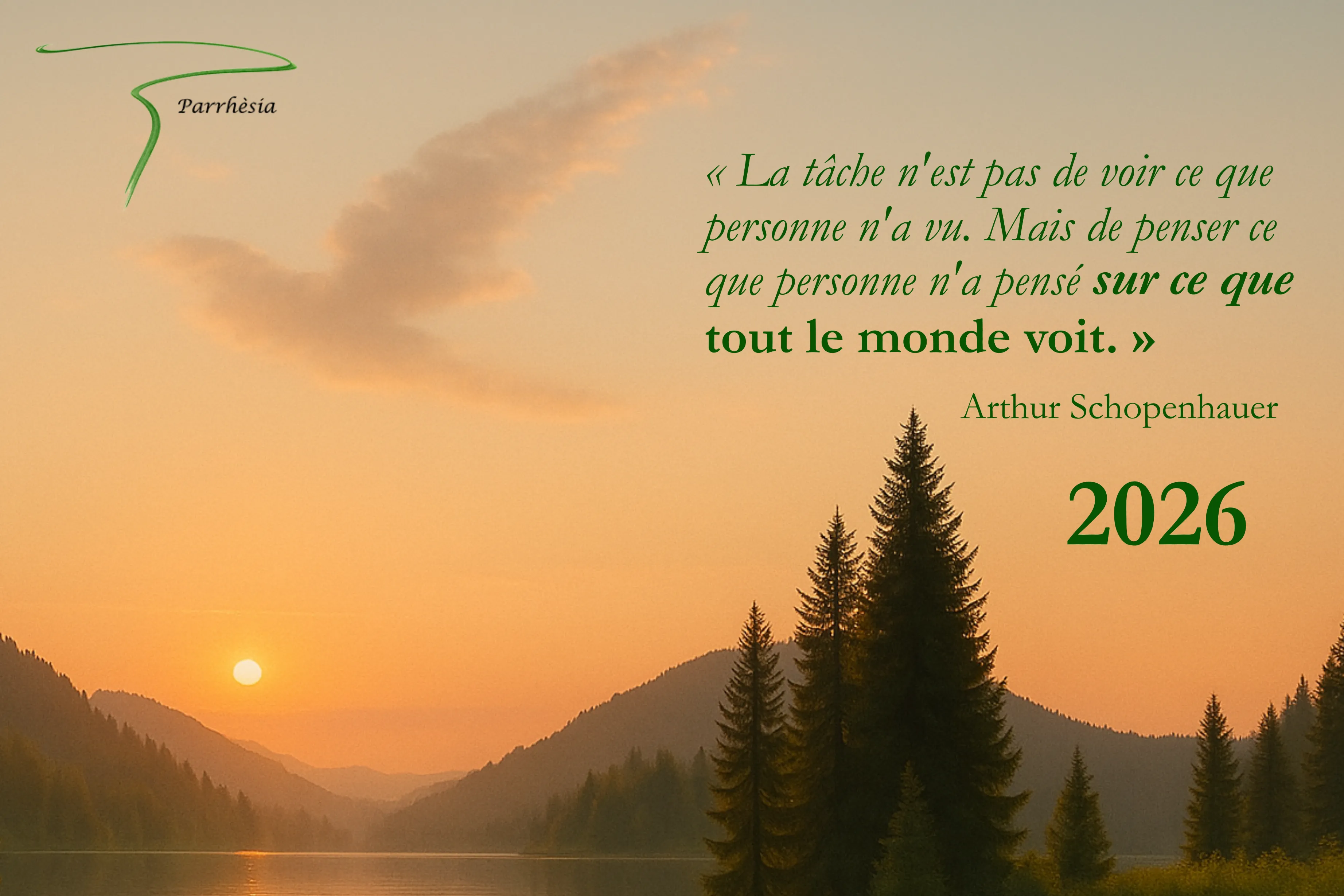L’humilité en entreprise : une vertu subversive dans un monde d’ego

Un monde d’egos hypertrophié
Nous vivons une époque où l’ego est roi. Narcissisme, mise en scène de soi, mépris subtil ou affiché de l’autre, instrumentalisation généralisée des relations humaines : tout pousse à la survalorisation de soi au détriment de la vraie altérité (loin de l’idéologie dite de « l’inclusivité » qui ne reconnaît comme « autre et différent » que les « autres et différents » qu’elle tolère….) L’autre n’est plus une fin, mais un moyen ; un levier, un obstacle ou un spectateur, rarement un sujet à part entière.
L’invasion des Narcisses Immatures™ qui a fait si longtemps l’objet d’un déni profond en entreprise se révèle plus profonde qu’attendue par les entreprises malgré les nombreuses mises en garde et alertes…
Ce climat d’égocentrisme imprègne également le monde de l’entreprise, où les logiques de performance, d’ascension individuelle, de compétition et de communication de soi valorisent souvent l’arrogance déguisée en leadership, la domination maquillée en efficacité, l’égoïsme stratégique habillé de « personal branding » comme l’on dit à présent…
Dans ce contexte, parler d’humilité peut sembler déplacé, presque anachronique. Et pourtant, elle est plus que jamais nécessaire. Car l’humilité est une vertu de vérité et de relation, profondément subversive dans un monde qui triche (entre autres choses…) avec l’être.
I. L’humilité ou la vérité de soi : définitions et racines
Le mot humilité vient du latin humilitas, issu de humus : la terre. La personne humble est celle qui reste proche du sol, enracinée dans la condition humaine, dans la finitude, dans l’acceptation de sa place — à l’opposé de l’hybris tant dénoncée par l’antiquité grecque : cette démesure orgueilleuse qui prétend s’égaler aux dieux. L’humilité n’est donc pas un effacement, encore moins une négation de soi ; elle est un enracinement dans le réel. Elle suppose la reconnaissance lucide de ses limites, la conscience de sa dépendance à autrui et à ce qui le dépasse, et une disposition intérieure d’écoute, de disponibilité, de service.
Dans l’histoire de la pensée, cette vertu a connu des fortunes diverses. Les Grecs anciens ne la plaçaient pas au sommet du panthéon moral : ce sont surtout les excès qui étaient condamnés, et la sôphrosunè (tempérance, modération) tenait lieu d’équilibre. Mais c’est dans la tradition chrétienne que l’humilité devient centrale : non seulement comme posture morale, mais comme accès au vrai. Saint Augustin affirme qu’elle est la base de toutes les vertus. La personne humble est celle qui sait qu’elle ne s’est pas faite elle-même, qu’elle ne peut grandir qu’en recevant et en servant (la grande dynamique du don et de la dette tant développée par Marcel Mauss).
Chez Pascal, l’humilité prend la forme d’une lucidité tragique : l’homme est un « roseau pensant », à la fois misérable (poussière dans l’univers) et capable de grandeur (en capacité de penser « l’infini »). Il doit accepter ce paradoxe, sans en fuir aucune des deux faces. Kant, de son côté, voit dans l’humilité la reconnaissance morale de notre égalité fondamentale, une manière de ne pas se situer au-dessus d’autrui mais à ses côtés.
Au fond, l’humilité est la vérité sur soi. Ni surestimation, qui mène à l’orgueil, ni fausse modestie, qui est une autre forme de mensonge. Mais un ajustement juste et serein, entre ce que nous sommes, ce que nous pouvons, et ce que nous devons.
II. Une vertu contre-culturelle en entreprise
Dans le monde professionnel contemporain, tout semble conspirer contre l’humilité. La réussite y est présentée comme une affaire purement individuelle, fruit d’un mérite personnel qu’il convient de mettre en scène sans cesse. Le culte du « personal branding » encourage à se vendre, à se mettre en avant, à construire une image plus qu’un être. Le paraître prend la place de la profondeur, et l’autre devient un instrument, un outil, un rouage ou une menace.
Cette logique produit un climat vicié : cynisme, compétition sans limite, solitude morale. La confiance disparaît, la coopération devient suspecte, la parole se verrouille. L’arrogance prospère. Les erreurs ne sont plus des opportunités d’apprentissage mais des fautes à cacher (et celles des autres des horreurs dont il faut juger le coupable !) . Le manager n’est plus un guide mais un supérieur intouchable. L’humilité, dans cet univers, fait figure d’anomalie.
Et pourtant, elle est la clef. Car un manager humble n’est ni faible, ni effacé. Il est celui qui peut dire : « je ne sais pas », « j’ai besoin de vous », « j’ai pu me tromper ». Il écoute vraiment, il donne de la place, il construit sans chercher la lumière. Il exerce une autorité qui ne s’impose pas, mais qui attire. Il ne joue pas à paraître, il agit pour servir. Il ne cherche pas la domination, il cultive l’alliance.
L’humilité est un courage. Celui de ne pas tricher avec soi-même. Celui de renoncer à l’illusion de l’autosuffisance. Celui de faire place à l’autre. C’est une puissance sereine, mais ferme. Une manière d’habiter sa fonction sans se confondre avec elle. Une manière d’être vrai.
III. L’humilité managériale : un ferment de confiance
Quand elle irrigue une équipe, l’humilité change tout. Elle libère la parole, rend possible une critique non destructrice, désamorce les conflits avant qu’ils ne dégénèrent. Le manager humble donne aux autres le droit d’exister pleinement, avec leurs compétences, leurs failles et leurs idées. Il ne cherche pas à tout contrôler, mais à faire grandir. Il ne prend pas toute la place, mais crée de l’espace.
Dans cette dynamique, l’ambition n’est plus une course solitaire mais une visée commune (le fameux « bien commun » tant perdu de vue aujourd’hui). L’énergie collective se régénère au contact de cette posture juste, solide et ouverte. L’humilité devient alors un levain, discret mais essentiel, d’une culture de travail fondée sur le respect, la coopération et le sens.
Elle ne dévalorise pas l’autorité, elle l’enracine dans une forme de service. Elle ne diminue pas la responsabilité, elle l’élargit. Elle ne gomme pas les tensions, mais les traverse avec maturité. Elle ne supprime pas les désaccords, mais les rend féconds.
Conclusion
Dans un monde obsédé par l’image, par la mise en avant de soi, par la conquête des apparences, l’humilité semble presque déplacée. Et pourtant, elle est ce qui rend le travail juste, la relation saine, le management fécond. Non pas en dévalorisant, mais en révélant. Non pas en niant la compétence, mais en la mettant à sa juste place. Non pas en effaçant l’autorité, mais en la fondant dans le service.
Redonner à l’humilité sa place dans l’entreprise, c’est ouvrir ce qui était fermé : un chemin de vérité, de confiance et de fécondité durable.
Sophie GIRARD &
Jean-Olivier ALLEGRE
Philosophe (toujours), consultant (très souvent), veilleur (autant que possible)

Brève méditation sur la violence
La violence ne triomphe pas seulement en frappant, mais en contaminant ; lui résister suppose lucidité, refus de l’escalade et courage d’une parole qui accepte le risque.
Inscription newsletter
Pour ne manquer aucun billet de PARRHESIA, laissez-nous vos coordonnées et votre adresse e-mail. Nous serons ravis de vous compter parmi nos abonnés.