La dignité humaine au cœur du management 1/2
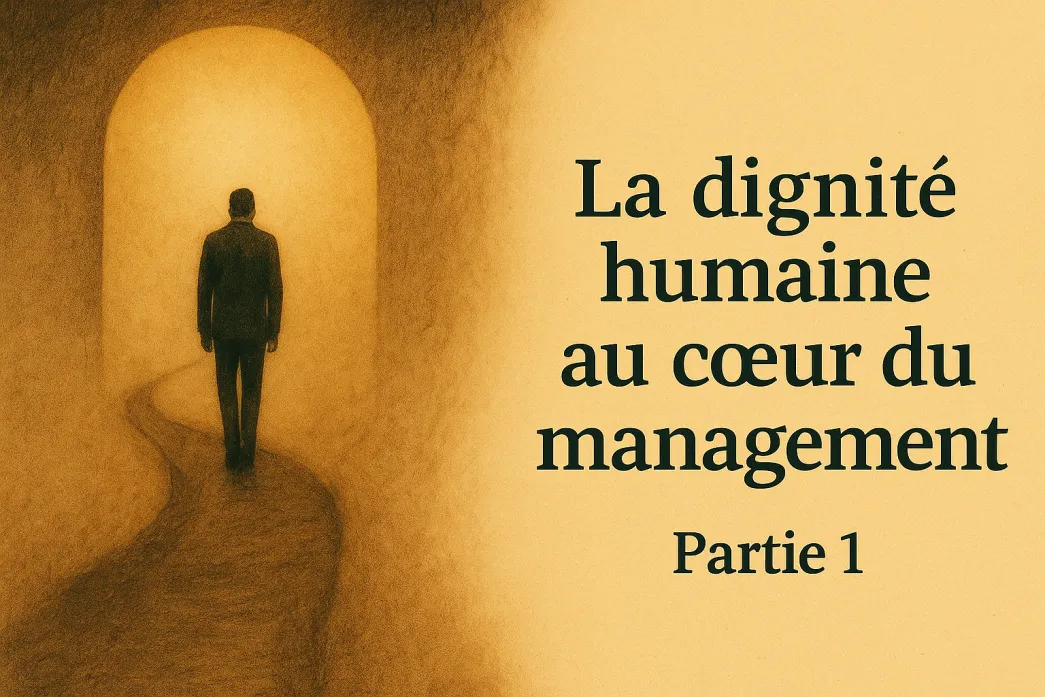
Une question fondamentale et fondatrice
Selon Martin Heidegger, tout philosophe est « hanté par une seule question »; il n’est, en fin de compte, le penseur que d’une seule question…
La mienne est « simple » à poser, mais il est si difficile d’y répondre…
« Qu’est-ce devenir “humain” ? » Autrement dit : comment réaliser notre humanité ? Plus qu’une question, c’est une pérégrination, un chemin de vie.
Existe-t-il, pour un être humain, une question à la fois plus fondamentale et plus fondatrice ?
Peut-on vivre dans l’ignorance de ce que l’on est ? De qui l’on est ?…
La réponse est… oui. Mille fois oui. Dix mille fois oui.
Il apparaît « normal » pour une immense majorité de la population de ne pas se poser cette question.
Je suis un « Homme », donc je suis humain.
Souvent, la réponse à cette question est le mépris : « comment peut-on se poser de telles questions »? Sous entend, comment peut-on perdre son temps avec une question telle que celle-là ? Il semble en effet que bien peu de gens aient le temps de tenter d’y répondre, et ceci, visiblement, depuis l’aube de l’humanité..
Et pourtant…
Nous pouvons être des « Hommes » sans être humains.
Nous naissons animal, et nous pouvons le demeurer.
Nous pouvons devenir humain en réalisant le meilleur de notre nature ; mais nous avons aussi cette option sublime et terrible de devenir non seulement moins qu’humain, mais parfois pire que les animaux : un barbare.
En tant qu’être humain, nous pouvons utiliser toute notre intelligence en vue du sublime, mais également pour le pire, et dans les pires perversités. Et les exemples sont légion, et le siècle dernier a inventé et concrétisé la barbarie totalitaire, d’abord dans sa version du socialisme soviétique en 1917 avec Lénine et Trotsky (poursuivi avec zèle par Staline), puis dans le national-socialisme allemand dans les années 1930 sous l’égide d’Hitler…
Par « barbare », j’entends ici celui qui trahit délibérément son humanité, non pas par ignorance ou faiblesse, mais en mettant sa conscience, son intelligence, sa lucidité au service du mal, de la destruction ou de l’humiliation de l’autre.
Le barbare n’est pas celui qui ignore la civilisation, mais celui qui la connaît… et la foule aux pieds. Il est, en cela, pire que l’animal, qui obéit à l’instinct, là où le barbare agit avec discernement, avec intention, parfois même avec méthode.
Le barbare, c’est celui qui instrumentalise tout : les idées, les règles, les autres êtres humains, au service de sa domination, de son plaisir, ou de sa vengeance.
Il désire nuire en connaissance de cause. Il jouit de l’inversion des valeurs, du mensonge, de la cruauté.
Et plus son intelligence est grande, plus sa capacité de perversion est redoutable.
Il n’est pas rare de croiser des formes de barbarie dans le monde du travail, dans les logiques de pouvoir, dans certaines stratégies d’humiliation ou de manipulation.
Aussi subtil qu’il soit, ce basculement vers l’inhumain peut s’infiltrer dans les structures, les pratiques, les discours… jusqu’à devenir invisible.
Alors, poser la question de la dignité humaine, et plus précisément dans le cadre professionnel, peut paraître bien dérisoire. Mais il va se révéler que ce pseudo « dérisoire » pourrait bien s’avérer… décisif.
Qu’est-ce que la dignité humaine ?
Le mot revient parfois, dans les discours comme dans les valeurs affichées par certaines entreprises : dignité.
Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Et surtout, en quoi la dignité humaine concerne-t-elle la vie professionnelle, le travail, le management ?
Le terme de « dignité » désigne une valeur absolue reconnue à un être, indépendamment de son utilité, de sa performance ou de sa reconnaissance sociale.
Appliquée à l’être humain, la dignité humaine signifie que tout individu, du seul fait qu’il est « Homme », mérite respect, protection et reconnaissance. Il ne peut jamais être traité comme un simple moyen, un outil ou une variable d’ajustement.
Cette dignité n’est ni une récompense, ni le fruit d’un mérite : elle précède l’action. Elle est inconditionnelle.
Mais cette affirmation généreuse pose une question fondamentale :
Si tout être humain possède une dignité, alors qu’en est-il de ceux qui ne manifestent ni conscience morale, ni empathie, ni souci de l’autre ?
Peut-on réellement parler d’une dignité humaine universelle… quand certains semblent ne jamais entrer dans leur propre humanité ?
Pour répondre à cette tension, il nous faut distinguer deux niveaux d’humanité — et donc deux formes de dignité : celle de l’individu et celle de la personne.
Individu et personne : une distinction essentielle
Un individu désigne un être humain dans son état fondamentalement biologique ou social. C’est l’être humain comme réalité naturelle : il appartient à l’espèce humaine, mais reste encore principalement guidé par ses instincts, ses besoins immédiats, ses pulsions ou ses conditionnements. Il est « humain » biologiquement, mais n’a pas encore réalisé pleinement son potentiel d’humanité. C’est, pour ainsi dire, un humain en devenir, « non actualisé ».
Une personne, à l’inverse, désigne un être humain qui a dépassé le stade de la simple animalité ou du conditionnement social immédiat.
La personne réalise son humanité de manière effective en se comportant comme un sujet libre, conscient, responsable, capable d’empathie, doté d’une conscience morale et spirituelle.
Elle n’est plus simplement portée par ses instincts ou ses automatismes, mais agit de manière réfléchie, libre et orientée.
Être pleinement une personne, c’est accomplir, au moins en partie, ce que l’on porte en soi de plus profondément humain.
Petite précision : qu’est-ce qu’une « conduite digne » ?
Dire que l’être humain possède une dignité, c’est reconnaître en lui une valeur qui mérite d’être respectée.
Mais vivre dignement, ce n’est pas simplement se savoir porteur de cette valeur.
C’est aussi se comporter en accord avec elle.
Autrement dit, la dignité humaine ne se limite pas à un statut ontologique : elle appelle une manière d’être, une manière de se tenir dans l’existence, face à soi-même, aux autres, au monde.
Une conduite digne, c’est une manière d’agir qui manifeste concrètement ce que l’être humain a de plus proprement humain.
On pourrait dire :
Est digne celui qui agit comme une personne, et non comme un simple individu.
Une conduite digne implique :
• Assumer sa liberté intérieure : ne pas se laisser entièrement gouverner par ses impulsions, peurs ou intérêts immédiats.
→ Une conduite digne commence là où commence la liberté.
• Reconnaître la dignité d’autrui : ne jamais utiliser l’autre comme un moyen, mais le traiter comme un sujet.
→ Une conduite digne est toujours relationnelle.
• Chercher à s’élever : viser le vrai, le juste, le bien ; refuser de rester enfermé dans l’immédiat ou le cynisme.
→ Une conduite digne élève, en soi et autour de soi.
• Assumer ses responsabilités : reconnaître ses actes, ses limites, ses erreurs.
→ La dignité se prouve dans l’épreuve.
• Agir avec cohérence : aligner ce que l’on pense, ce que l’on dit et ce que l’on fait.
→ Une conduite digne est une conduite unifiée.
En entreprise, cela implique :
• Respecter chacun, quel que soit son rôle ou sa performance.
• Exprimer les choses avec clarté mais sans violence.
• Décider avec justice pour atteindre la performance, mais sans sacrifier l’humain au nom de l’efficacité.
• Être exemplaire non pour l’image, mais en acte pour sa cohérence personnelle.
• Reconnaître ses erreurs sans se défausser.
• Ne pas trahir ses principes sous pression.
La dignité humaine n’est pas seulement un principe à respecter chez les autres.
C’est une exigence intérieure, une manière d’habiter pleinement son humanité — dans ses choix, ses gestes, sa présence.
(Fin de la première partie. Seconde et dernière partie à suivre dans notre prochain article)
Jean-Olivier ALLEGRE
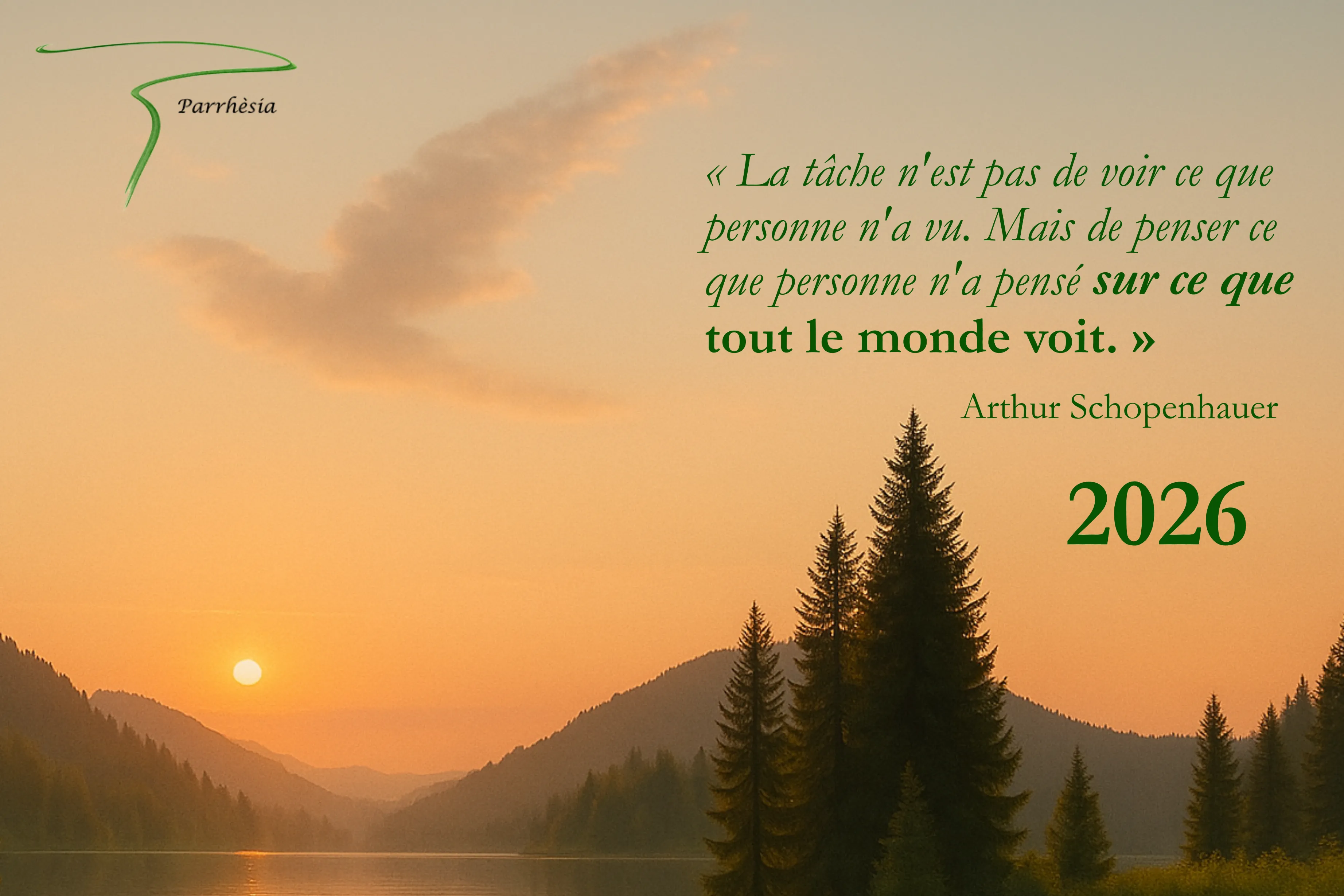
2026 : La Parrhèsia va-t-elle disparaître ?
Une entreprise, une pratique : dire vrai pour tenir la performance.
Un défi majeur (impossible ?) en 2026 !

L'autorité et ses démesures 2/2
De la dictature qui s’installe sous prétexte d’urgence jusqu’au totalitarisme qui prétend refaçonner l’homme lui-même, ce second épisode poursuit la généalogie des démesures du pouvoir — et s’interroge sur ce qu’il reste d’humain quand l’autorité oublie qu’elle doit servir.
Inscription newsletter
Pour ne manquer aucun billet de PARRHESIA, laissez-nous vos coordonnées et votre adresse e-mail. Nous serons ravis de vous compter parmi nos abonnés.
