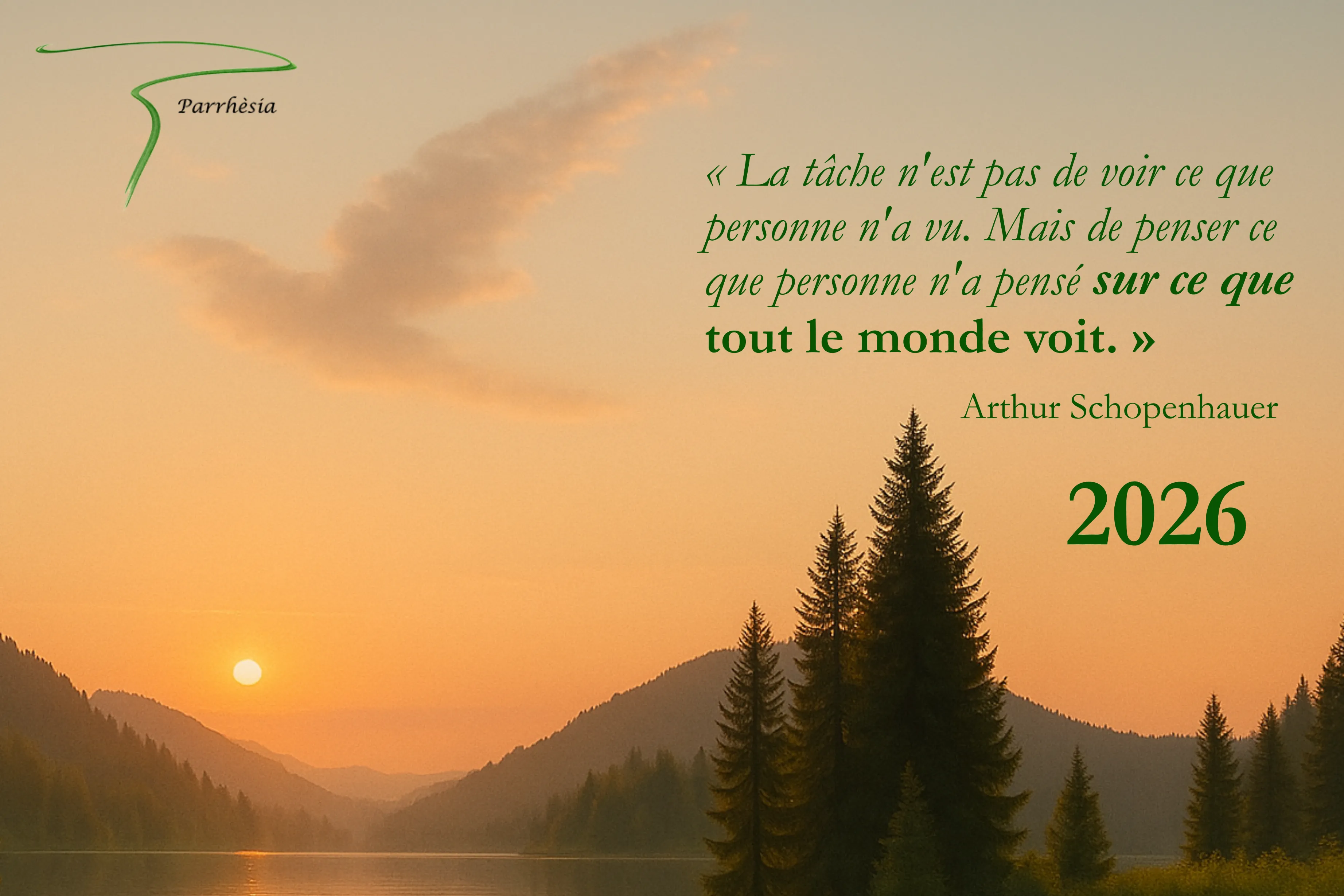La dignité humaine au cœur du management 2/2
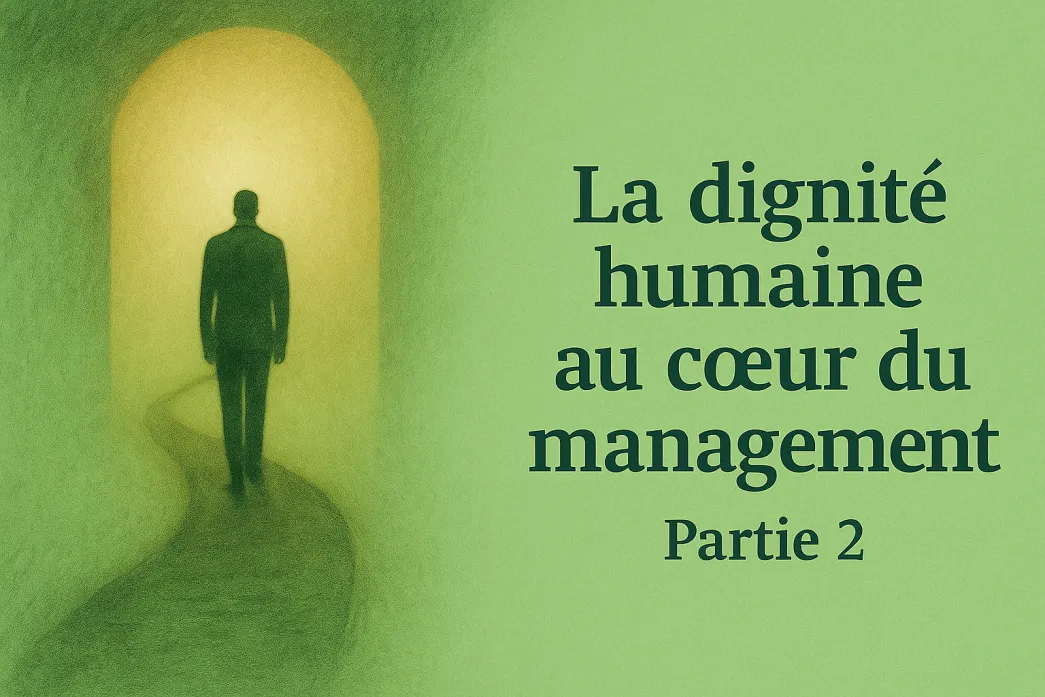
La première partie de cet article (à retrouver ICI) nous a conduits à interroger ce que signifie « devenir humain » — et à distinguer l’individu, la personne, et le barbare.
Ce second temps prolonge la réflexion, en descendant de la hauteur de la pensée vers le terrain concret de l’entreprise.
Car s’il est essentiel de fonder la dignité, il l’est tout autant de la faire vivre dans nos manières de manager, de décider, de nous rapporter aux autres.
Comment reconnaître la dignité dans l’autre, même lorsqu’elle n’est pas encore réalisée ?
Et comment accompagner chacun, à la hauteur de ce qu’il peut devenir ?
Pourquoi la distinction « individu / personne » est-elle fondatrice en entreprise ?
Reconnaître cette distinction permet de clarifier ce que l’on entend par « respect de la dignité humaine » :
• Tout individu, même s’il demeure dans des logiques de protection de soi, d’hostilité ou d’égoïsme, mérite un respect fondamental. Pourquoi ? Parce qu’il porte en lui — potentiellement — la capacité d’évoluer, de devenir une personne.
Nier cette dignité reviendrait à figer l’autre dans son état actuel, à l’enfermer dans son incomplétude.
• La dignité pleinement réalisée, en revanche, correspond à l’état de personne : une dignité vivante, consciente, assumée, exprimée.
Elle se manifeste dans les choix, les responsabilités prises, la qualité de la relation à autrui, la capacité à poser des actes libres et justes.
En management, cette distinction est déterminante : on ne travaille pas seulement avec des fonctions ou des individus, on travaille avec des personnes en devenir.
La dimension spirituelle : clef de l’humanité authentique
Mais qu’est-ce qui permet à un individu de devenir pleinement une personne ?
Ce n’est pas seulement l’acquisition de compétences ou l’adoption de comportements adaptés.
Ce passage suppose une élévation intérieure, une réalisation spirituelle au sens profond du terme.
Par spiritualité, entendons la capacité à :
• dépasser ses déterminismes,
• s’interroger sur le sens de ce que l’on vit,
• faire des choix libres et orientés vers un bien supérieur (le vrai, le juste, le bon),
• se situer dans une relation vivante et responsable à soi, aux autres, au monde — voire à une transcendance.
La personne ne se résume pas à ses fonctions. Elle est, au fond, un sujet capable d’un rapport éthique et spirituel à l’existence.
Le management peut alors être envisagé comme un espace d’accompagnement : non pas seulement organiser le travail, mais aider chacun à se construire comme personne.
Manager comme un animal ou comme un humain ?
La question posée à chaque manager, souvent de manière inconsciente, est celle-ci :
Comment vais-je exercer mon pouvoir ? Comme un « animal » ? Ou comme un « humain » ?
L’animal dominant impose, contrôle, conditionne, récompense ou punit. Il obtient des comportements. Il dresse.
Mais le manager humain, lui, ne se contente pas de piloter des résultats : il s’adresse à la personne, il parle à la conscience, il invite à la responsabilité. Il réveille ce qui, dans l’autre, peut encore grandir.
Et inversement :
Est-ce que je considère ceux que je manage comme des animaux qu’il faut domestiquer ? ou comme des personnes libres et dignes qu’il faut élever ?
Un management strictement fonctionnel, fondé sur l’anticipation des réactions, la peur, la récompense ou le silence, est un management « animal » qui abaisse.
Il fonctionne… mais il rabaisse.
À l’inverse, un management qui s’adresse à la part la plus humaine de l’autre — sa liberté, sa conscience, sa recherche de sens — est un management humanisant.
La question n’est donc pas simplement technique. Elle est éthique, existentielle.
Manager, c’est choisir quel regard je porte sur l’autre — et sur moi-même.
Manager : accompagner l’individu vers la personne
Cette vision exigeante du management repose sur deux piliers :
1. Respecter la dignité de l’individu, même quand elle n’est pas encore réalisée. C’est refuser toute forme de mépris, de réduction à la fonction, d’instrumentalisation.
L’individu est toujours digne parce qu’il est porteur d’un appel à devenir plus humain.
2. Encourager la transformation vers la personne : c’est-à-dire créer les conditions où chacun peut se libérer de ses automatismes, de ses « mécaniques », c’est-à-dire de ses modes de fonctionnement « machinaux », assumer sa liberté, entrer dans une dynamique éthique, responsable et spirituelle.
Concrètement, cela implique :
• Une culture de la parole vraie (parrhèsia) : sincère, directe, respectueuse, sans faux-semblants.
• Une exigence éthique dans les pratiques quotidiennes : pas de manipulation, pas d’humiliation, pas de double discours.
• Un management qui valorise l’intériorité, la conscience, la responsabilité, plutôt que la simple conformité.
• Une ouverture au sens, à la vocation, à ce qui, dans le travail, relie chacun à quelque chose de plus vaste que lui.
Dignité potentielle et dignité réalisée
Tout être humain, en tant qu’individu, possède une dignité inaliénable, parce qu’il porte en lui le potentiel d’une humanité plus haute.
Mais c’est à travers la liberté, l’engagement et la quête de sens que ce potentiel devient effectif — que l’individu devient une personne.
Le rôle du management ne devrait-il pas être, alors, de reconnaître cette dignité en germe… et d’accompagner sa réalisation ?
Plutôt que de chercher à optimiser des fonctions, pourquoi ne pas chercher à faire grandir des personnes ?
C’est peut-être cela, au fond, manager véritablement :
Offrir à chacun l’espace et la confiance nécessaires pour passer de l’individu fonctionnel à la personne libre et responsable.
Jean-Olivier ALLEGRE

Brève méditation sur la violence
La violence ne triomphe pas seulement en frappant, mais en contaminant ; lui résister suppose lucidité, refus de l’escalade et courage d’une parole qui accepte le risque.
Inscription newsletter
Pour ne manquer aucun billet de PARRHESIA, laissez-nous vos coordonnées et votre adresse e-mail. Nous serons ravis de vous compter parmi nos abonnés.