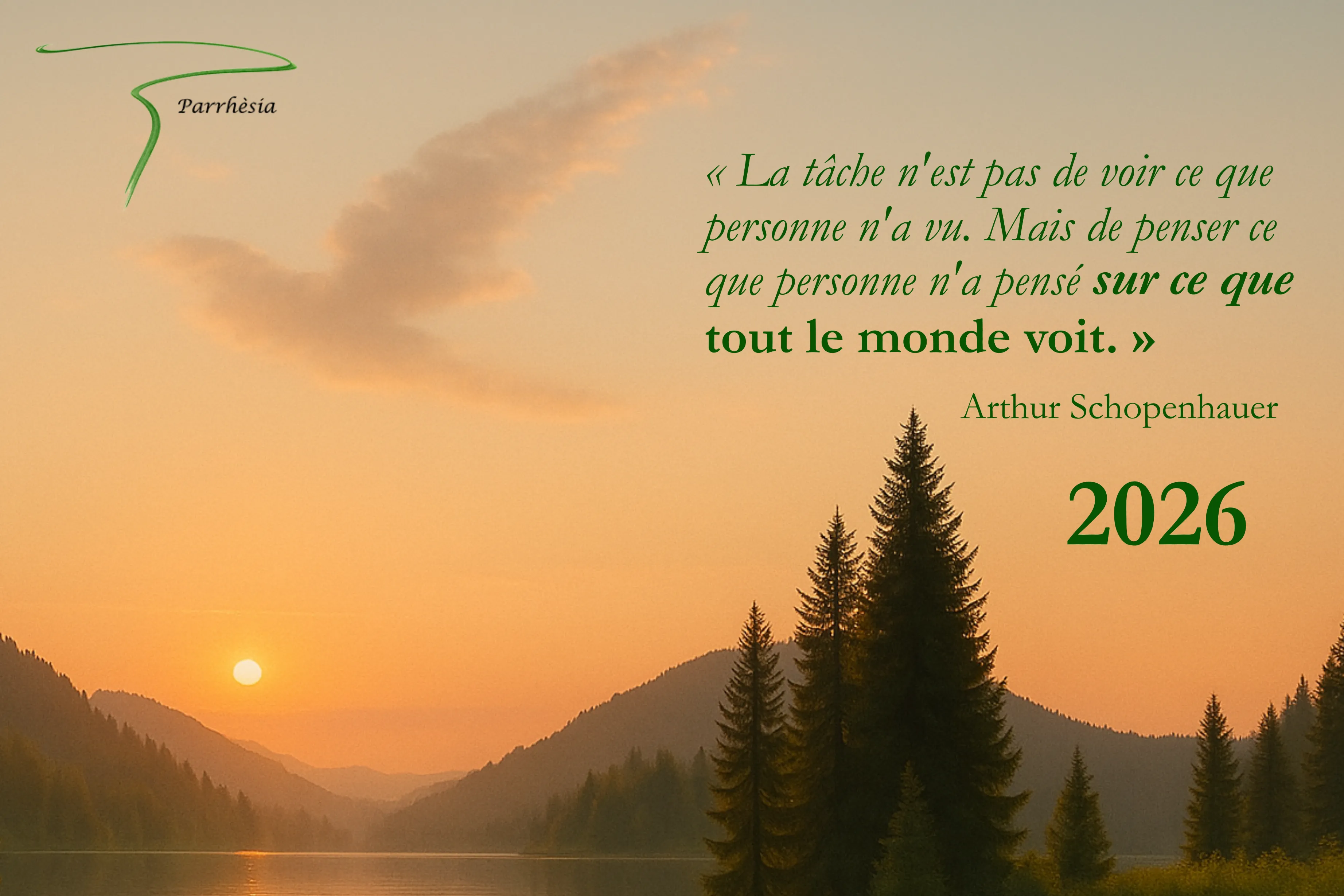L’autorité et ses démesures 1/2

Peu de temps ? RÉSUMÉ DE L’ÉPISODE 1
Nous partons d’une question simple : qu’est-ce que le pouvoir, et jusqu’où peut-il aller ? Nécessaire à la vie collective, il révèle la vérité de ceux qui l’exercent, entre service et emprise.
Face à la dissolution de l’autorité véritable dans la technocratie ou le vide, nous reprenons le chemin des origines pour en retrouver le sens.
L’auctoritas, issue du verbe augere (« faire croître »), désigne une autorité qui fonde, qui élève, qui se reçoit d’un bien commun.
Mais lorsqu’elle se déforme, elle devient autoritarisme, pouvoir sans écoute, puis autocratie, pouvoir solitaire sans contrepoids.
Ce premier épisode retrace cette dérive initiale : comment le pouvoir, né pour servir et unir, commence déjà à se replier sur lui-même.
Prologue – Qui gouverne ? Pourquoi ? Jusqu’où ?
Le pouvoir. Ce mot que l’on prononce tous les jours sans jamais en sonder la profondeur ni en mesurer tous les enjeux. Il se donne comme une nécessité de l’organisation collective — et il l’est. Mais il est aussi un révélateur : il met à nu la personnalité profonde des personnes, il dévoile la vérité de ce qu’elles portent en elles, qu’il s’agisse de grandeur ou de médiocrité. Il est une tentation, un vertige, une dérive. Il commence comme charge, et finit parfois comme fardeau jeté sur les autres. Il peut être autorité, ou emprise. Service, ou soumission. Promesse de paix, ou machine de guerre.
À l’heure où l’autorité véritable semble se dissoudre dans l’expertise molle ou le pilotage technocratique, où les logiques de pouvoir se maquillent en gouvernance fluide, elle se dissout plus radicalement encore dans le rien, dans le vide, dans le nihilisme — quand plus personne ne veut l’exercer. Il devient urgent de refaire le chemin. Reprendre à la racine. Nommer les formes historiques de l’abus, non pour dresser une galerie de monstres, mais pour reconnaître les visages de nos renoncements. Car l’Histoire, ici, n’est pas un musée : elle est un miroir toujours vivant, dont chacun peut faire l’expérience.
L’autorité légitime – Le pouvoir comme service
La racine des termes…
Le mot « autorité » vient du latin auctoritas, lui-même dérivé du verbe augere, qui signifie « faire croître », « faire naître », « produire à l’existence ». À Rome, l’auctoritas n’était pas confondue avec le pouvoir effectif (potestas). L’adage populaire, rapporté par Cicéron, le rappelait : Potestas in populo, auctoritas in senatu — « le pouvoir appartient au peuple, l’autorité au Sénat ».
La potestas renvoie au pouvoir qui s’impose, qui commande et qui contraint. L’auctoritas, au contraire, désignait une qualité symbolique et fondatrice, une légitimité reconnue, souvent associée aux Anciens. Elle ne se traduisait pas par un pouvoir décisionnel ou exécutif, mais par une force d’inspiration, par une capacité à donner poids, profondeur et légitimité à la parole ou à l’action des autres. Elle était reçue, héritée, transmise de ceux qui avaient posé les fondations pour les choses à venir. Les détenteurs de l’auctoritas étaient ainsi les garants d’une fondation sacrée, enracinée dans la mémoire et dans le temps long.
C’est pourquoi l’autorité n’est pas synonyme de pouvoir. Elle peut même exister sans force coercitive, et jusqu’à incarner un contre-pouvoir d’ordre symbolique. Comme le rappelle Benveniste, augere désigne avant tout un acte créateur, fondateur, presque mythique, qui fait apparaître une chose pour la première fois. Dans cette même racine, l’auctor est celui qui fonde une parole et s’en porte le garant. L’« auteur » n’est pas seulement celui qui écrit, mais celui qui crédibilise une parole, qui inaugure une voie, qui rend possible un héritage.
Ainsi, l’autorité, en son sens originel, n’a rien à voir avec l’ordre donné ou le commandement imposé. Elle n’est pas une posture de supériorité, mais une capacité d’engendrement : elle fait advenir, elle met au monde, elle fonde.
Le cœur du mécanisme…
Partout où il y a communauté humaine, il faut de l’ordre, une parole structurante, une voix qui arbitre, une main qui relie. L’autorité est cette fonction verticale qui empêche les relations horizontales de se dissoudre dans l’indifférence ou de s’exploser dans le conflit permanent. Mais elle ne vit que si elle se reçoit d’un bien commun, s’exerce dans un cadre juste, et demeure contestable sans être discréditée.
Elle est d’autant plus forte qu’elle ne cherche pas à s’imposer. Elle n’a pas besoin d’écraser pour tenir. Elle ne repose pas sur la contrainte, mais sur la reconnaissance. Elle ne s’auto-proclame pas : elle se reçoit d’un héritage, et se confirme dans la confiance.
Concrètement…
L’autorité véritable se reconnaît dans la fermeté tranquille d’un chef respecté, dans la parole sobre d’un enseignant qu’on n’ose pas trahir, dans la présence d’un juge qui écoute avant de trancher. Elle est capable de dire non sans humilier, d’assumer un cap sans se confondre avec lui. Elle peut être paternelle sans être infantilisante, fondatrice sans être possessive.
Elle s’incarne à chaque fois qu’une parole ou un geste fait grandir, qu’une décision ouvre un espace plutôt qu’elle ne le referme, qu’une responsabilité assumée libère au lieu d’asservir. L’autorité est moins un privilège qu’un service, moins une force imposée qu’une fécondité donnée.
Autoritarisme – Le pouvoir sans écoute
La racine des termes…
Le mot « autoritarisme » vient du latin auctoritas — la capacité de faire croître, l’autorité — associé au suffixe -isme, qui désigne une attitude, un comportement, une idéologie ou une doctrine. Par ce glissement, ce qui relevait de l’auctoritas comme puissance de croissance se rigidifie en système. L’autorité se dénature et se transforme en tendance à imposer, en volonté de domination.
Ainsi, l’autoritarisme conserve la racine de l’auctoritas, mais en trahit l’essence. Il ne fait plus croître : il contraint. Il ne structure pas : il verrouille. C’est l’autorité vidée de sa légitimité, devenue pur exercice de contrôle.
Le cœur du mécanisme…
L’autoritarisme se joue à deux niveaux. Il peut désigner la tendance d’une personne à abuser de son autorité, à l’exercer avec dureté, à chercher à l’imposer. Mais il désigne aussi un type de régime politique : un pouvoir qui n’est pas fondé sur une légitimité démocratique, mais sur la force.
Dans ces logiques, le pouvoir n’est pas partagé, l’exécutif n’est pas contrôlé. Les élections, lorsqu’elles existent, ne sont qu’une apparence : un décor destiné à légitimer le régime et à neutraliser l’opposition. Le débat est suspect, la nuance perçue comme faiblesse. Le pouvoir autoritaire ne cherche pas l’adhésion, mais la soumission silencieuse. Ce n’est pas encore la terreur, mais déjà l’intimidation.
Concrètement…
L’autoritarisme se reconnaît à travers une série de symptômes récurrents : développement de la propagande, embrigadement de la jeunesse, réglementation de la vie sociale et culturelle, dirigeants cooptés plutôt qu’élus, restriction des libertés d’association, d’expression ou d’opinion. Les opposants sont bannis, exilés, emprisonnés, persécutés. La loi ne protège plus : elle discipline. Le citoyen n’est plus appelé à penser, mais à suivre.
Ce n’est pas encore la dictature. C’est la crispation d’un pouvoir qui se sait fragile, et qui croit se renforcer en muselant.
Autocratie – Le pouvoir solitaire
La racine des termes…
Le mot « autocratie » vient du grec autos (soi-même) et kratos (pouvoir). Littéralement : « le pouvoir par soi-même ». L’autocrate n’a besoin ni de délégation, ni de consentement. Il tire sa légitimité de lui-même, ou plutôt, il se la confère. Son autorité ne s’appuie ni sur une loi supérieure, ni sur une reconnaissance mutuelle, mais sur une conviction intime de sa propre légitimité. L’autocratie, dès son étymologie, porte donc une rupture : celle du lien entre le pouvoir et le peuple, entre la décision et la délibération.
Le cœur du mécanisme…
L’autocratie n’est pas nécessairement violente, mais elle est toujours exclusive. Un seul homme décide, sans partage, sans contre-pouvoir, sans débat public réel. Ce n’est pas l’arbitraire d’un tyran, mais la certitude tranquille de celui qui pense que son jugement suffit. L’autocratie repose sur la concentration du pouvoir, mais aussi sur la croyance, souvent sincère, que cette concentration est la condition de l’efficacité. Elle séduit par la promesse de rapidité, de clarté, de simplicité : un seul décide, les autres exécutent.
Peu à peu, la verticalité remplace la délibération. Le cercle du pouvoir se referme, jusqu’à devenir miroir : l’autocrate ne consulte plus que lui-même, ou ceux qui pensent comme lui. Il s’entoure de fidèles, de conseillers dociles, de relais loyaux. L’autocratie devient ainsi un système d’obéissance mutuelle, où chacun se protège en répétant la volonté du chef.
Concrètement…
L’autocratie se reconnaît à l’opacité des décisions, à l’absence de consultation authentique, à la concentration des leviers législatifs, exécutifs et parfois judiciaires dans une même main. L’État devient l’émanation d’une personne, d’un clan ou d’un réseau de fidélités croisées. L’administration se transforme en prolongement de la volonté du chef, les institutions cessent d’être des garde-fous pour devenir des instruments.
Ce n’est pas nécessairement la brutalité qui caractérise l’autocratie, mais la disparition progressive du dissensus : tout ce qui résiste, questionne ou nuance devient dissonant, donc dangereux. L’autocrate prétend gouverner pour le bien commun, mais il le définit seul. Et plus il concentre le pouvoir, plus il s’enferme dans sa propre conviction d’incarner la vérité.
(...) à suivre dans l'épisode 2...
Sophie GIRARD &
Jean-Olivier ALLEGRE
Philosophe (toujours), consultant (très souvent), veilleur (autant que possible)

Brève méditation sur la violence
La violence ne triomphe pas seulement en frappant, mais en contaminant ; lui résister suppose lucidité, refus de l’escalade et courage d’une parole qui accepte le risque.
Inscription newsletter
Pour ne manquer aucun billet de PARRHESIA, laissez-nous vos coordonnées et votre adresse e-mail. Nous serons ravis de vous compter parmi nos abonnés.