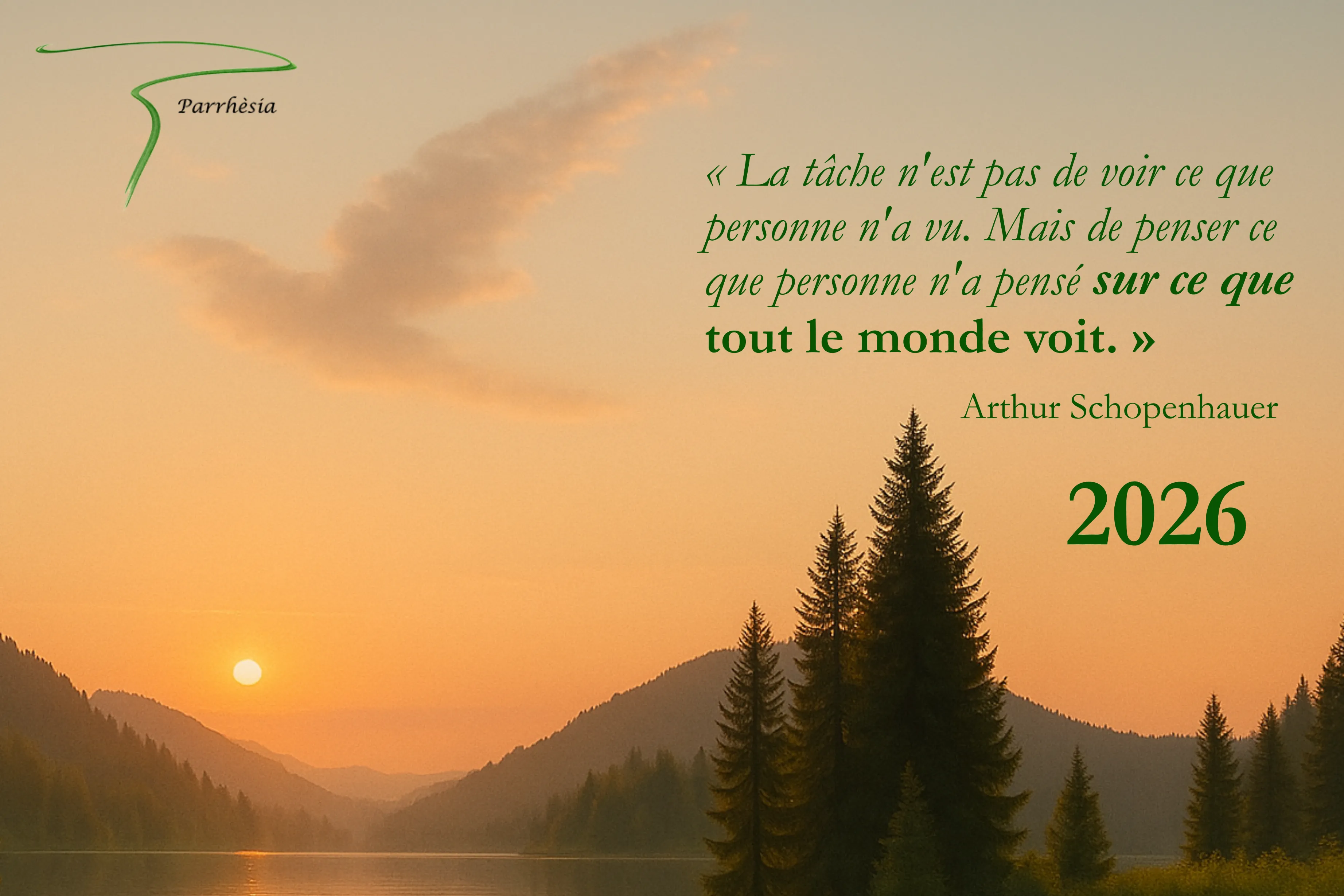La « cohésion » en question : unité, unanimité, uniformité 2/3
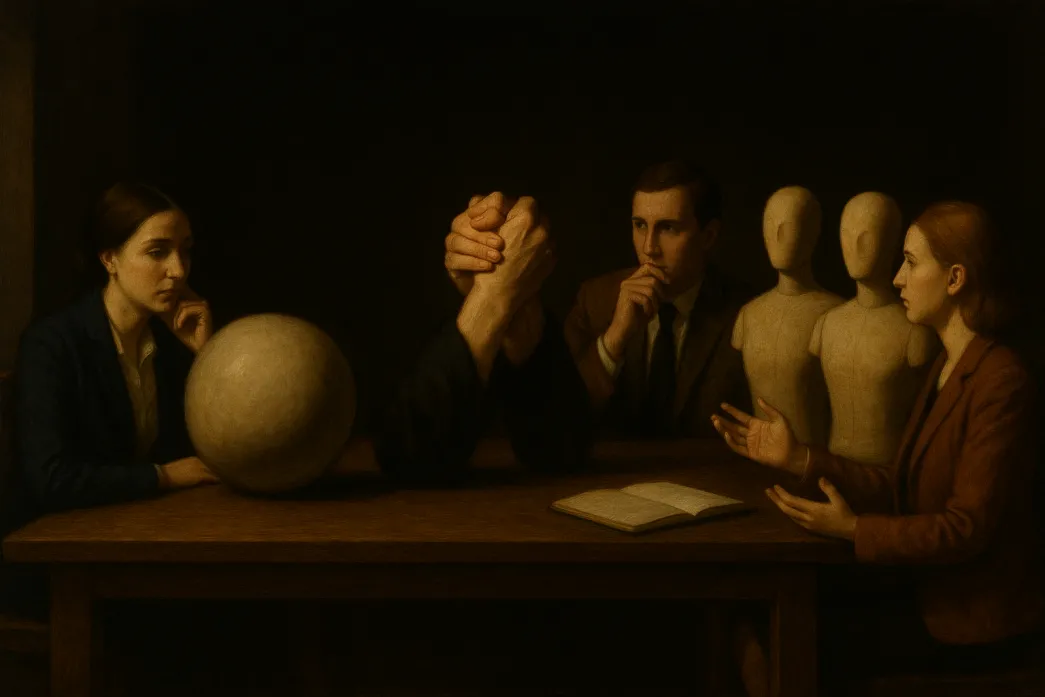
Avant le 3ème épisode qui mettra les 2 pieds et les 2 mains dans le quotidien de la vie professionnelle, nous vous proposons un temps de prise de recul, de respiration, avec une méditation philosophique à partir du cadrage de notre premier article, pour approfondir le mystère du Un à travers les trois formes : unité, unanimité, uniformité. Prêt ? Sinon… attendez le dernier épisode…
Vous avez manqué le premier épisode ? Pas de panique, il est ICI
Trois visages du Un : penser l’unité, traverser l’unanimité, résister à l’uniformité
Il y a en l’homme un désir d’unité. Une nostalgie d’un tout perdu. Nous ne supportons pas longtemps la dispersion, l’éclatement, la contradiction. Nous cherchons à réunir, à relier, à faire sens. Mais toutes les manières de faire Un ne se valent pas. Certaines libèrent, d’autres enferment. Certaines élèvent, d’autres écrasent.
Philosopher sur l’unité, l’unanimité et l’uniformité, c’est interroger trois manières de répondre au chaos par une forme d’ordre.
I. L’unité : la tension créatrice de la pluralité
L’unité véritable n’est pas donnée d’avance, elle se construit dans l’effort de la pensée, dans le respect de ce qui résiste à la fusion. Elle suppose un lien intérieur, une orientation commune, mais sans réduction. Comme l’enseignait Héraclite, « le conflit (Polémos) est père de toutes choses » : il y a dans la pluralité une force créatrice que l’unité n’a pas à supprimer, mais à féconder car l’unité se fait, selon lui dans et par « l’unité des contraires ».
Être un, ce n’est pas être seul ni identique, c’est être ordonné vers.
Le philosophe y voit une promesse : celle de l’harmonie sans confusion, d’un cosmos (au sens grec antique du terme) né du chaos. L’unité est toujours dynamique. Elle n’est pas immobilité, mais danse.
« Il faut porter en soi un chaos, pour mettre au monde une étoile dansante. »
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, prologue, §5
Autrement dit, l’unité ne réside pas dans le même, mais dans la relation. C’est pourquoi l’unité est politique au sens noble : elle suppose de faire vivre ensemble des différences irréductibles, sans les annihiler, autrement dit, et pour reprendre une concept fondateur au sein de Parrhèsia : coopérer (c’est-à-dire réaliser une oeuvre ensemble en étant tous (réellement) différents). Quel défi, non ? Surtout dans notre société actuelle tentée par le totalitarisme du même….
II. L’unanimité : la coïncidence fragile des consciences
Il est des moments rares où les consciences humaines vibrent à l’unisson. Un événement, une parole, une souffrance, une injustice les réunit. On parle alors d’unanimité : un même souffle, une même âme. Le philosophe se méfiera pourtant de cette harmonie immédiate. Car toute unanimité peut se renverser en son contraire : l’unanimisme.
L’unanimité devient toxique dès qu’elle refuse le dissensus, expulse l’hétérodoxe (celui qui pense autrement), sacralise le moment.
Platon le savait : l’opinion commune n’est pas la vérité. Et Rousseau, qui croyait en la volonté générale, butait déjà sur la question : qui parle vraiment ? qui est encore libre ? Une unanimité obtenue par peur, par lassitude ou par ruse n’est qu’un déguisement de la force…
Le philosophe ne rejette pas l’unanimité, mais il l’éprouve, la questionne, la traverse. Il sait que parfois elle est vraie, mais que souvent, elle est illusion. La vraie communion se donne à ceux qui acceptent de ne pas toujours être d’accord. Ce qui, dans nos temps modernes vous mettra en danger…
III. L’uniformité : la tentation moderne du même
L’uniformité est un faux Un. Elle repose sur une confusion entre égalité et identité, entre unité et répétition. Là où l’unité respecte la forme propre de chacun, l’uniformité impose une forme unique. C’est l’unité de la machine, non celle de la vie.
Nietzsche la pourfendait déjà : dans la volonté d’uniformiser, il voyait une haine de la grandeur, une peur de la différence. Aujourd’hui, l’uniformité avance masquée : dans les algorithmes, les normes, les processus, les langages managériaux. Elle prétend garantir la paix par la standardisation. Mais ce qu’elle appelle paix est une forme d’extinction.
Elle est le rêve des systèmes totalisants (et des pratiques totalitaires) : une société sans friction, une pensée sans aspérités, une humanité sans voix propre. Mais le philosophe y oppose le vivant. Car la vie n’est jamais uniforme : elle est variation, nuance, écart. C’est par la diversité que la vérité respire, et non par le calque.
Conclusion : penser ensemble sans se fondre, parler d’une seule voix sans se taire, s’accorder sans s’effacer
Penser ces trois termes, c’est dessiner une ligne de crête.
• L’unité est une quête : elle se construit dans le respect de l’autre.
• L’unanimité est une grâce (au sens plein du terme) : elle se reçoit, mais ne s’impose pas.
• L’uniformité est une menace : elle simplifie à mort.
À l’heure des injonctions au consensus, des process qui normalisent les esprits, des discours où chacun doit parler la langue de l’institution, penser ces distinctions devient un acte de résistance.
Le philosophe, ici, n’est pas seulement un penseur. Il est un veilleur. Il garde vive la différence entre un lien vivant et une prison mentale.
Ce qui est un par la relation vivra. Ce qui est un par la contrainte mourra.
Sophie GIRARD & Jean-Olivier ALLEGRE

Brève méditation sur la violence
La violence ne triomphe pas seulement en frappant, mais en contaminant ; lui résister suppose lucidité, refus de l’escalade et courage d’une parole qui accepte le risque.
Inscription newsletter
Pour ne manquer aucun billet de PARRHESIA, laissez-nous vos coordonnées et votre adresse e-mail. Nous serons ravis de vous compter parmi nos abonnés.