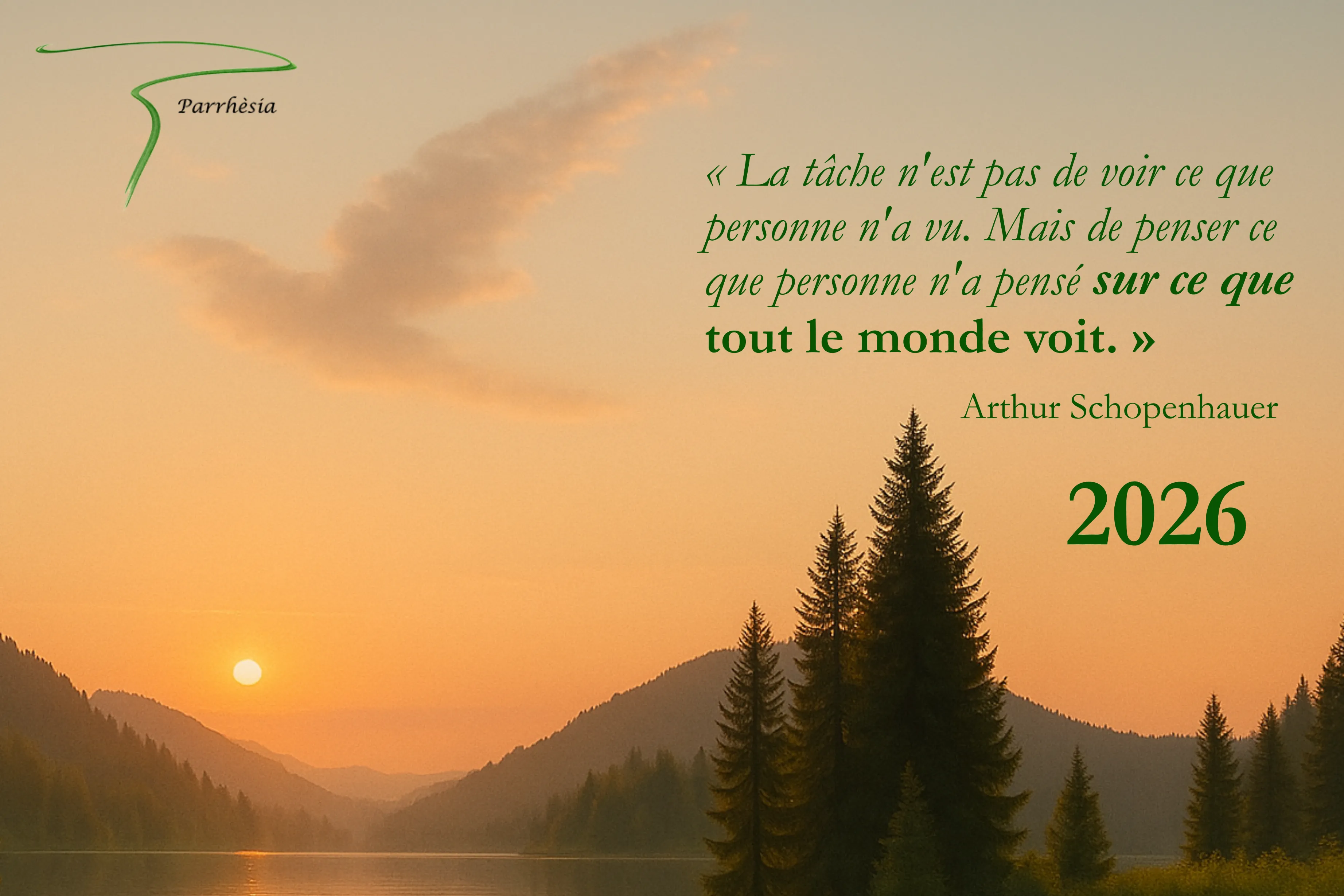Radical ou fanatique ? De l’urgence de ne pas confondre...

"Les mots ont un sens !" Épisode 3
Peut-on être radical sans passer pour un fanatique ?
Dans le monde professionnel (mais pas que…), la perte de culture faisant des ravages, certains mots deviennent suspects à force d’être mal compris. « Radical » est de ceux-là.
Qu’on l’emploie à propos d’une conviction, d’un choix stratégique, d’un positionnement managérial ou d’une manière d’exercer l’autorité, le terme dérange. Il semble trop dur, trop tranché, trop clivant.
À peine est-il prononcé qu’on l’associe à l’excès, à l’intransigeance, au risque de fracture.
Alors on l’évite. On le contourne. On le remplace par des mots plus rassurants : pragmatique, agile, modéré, consensuel…
Mais cette méfiance est-elle justifiée ?
Et surtout, que dit-elle de notre époque managériale ?
Peut-on encore tenir une ligne claire, assumer un choix profond, aller au bout d’une conviction — sans être aussitôt taxé de rigidité ou soupçonné de dérive autoritaire ?
Aujourd’hui, affirmer un cap sans céder peut passer pour du fanatisme.
À l’inverse, éviter toute tension, toute profondeur, toute décision un peu risquée… finit par dessiner une forme de vide managérial.
On se rappellera avec délice les retours suite à notre carte de vœux de 2022, dont la citation était :
et qui déchaîna autant les passions que les malentendus et les incompréhensions…
Alors la vraie question est là :
quelle est la différence entre un radical et un fanatique dans la vie professionnelle ?
Et plus encore : avons-nous encore le droit d’être radicaux — c’est-à-dire profondément cohérents — sans devenir dangereux pour l’équilibre collectif ?
Modeste tentative d’éclaircissement…
1. Radical et fanatique : deux mots, deux mondes
Les mots sont les sentinelles de notre pensée. Encore faut-il savoir les entendre.
Le mot radical vient du latin radix, radicis : la racine. Est radical celui qui retourne à ce qui fonde, à ce qui tient debout, à ce qui permet à la pensée, à l’action ou à la foi de porter du fruit. Le radical approfondit. Il cherche ce qui est premier, ce qui donne sens, ce qui appelle fidélité. Sa force vient de l’intérieur.
Le mot fanatique, lui, vient du latin fanaticus, dérivé de fanum, le temple. Il désignait un individu exalté, possédé, animé d’un zèle religieux sans mesure. Le fanatique ne pense plus, il applique. Il ne doute plus, il impose. Son énergie est extérieure, crispée, aveugle.
Ainsi, dès l’origine, une ligne de fracture :
le radical est enraciné dans une exigence vivante,
le fanatique est arraché à toute vérité incarnée.
2. Approfondir ou imposer : deux postures opposées
Être radical, ce n’est pas être extrémiste. C’est refuser les compromis de surface. C’est aller au bout de sa conscience, au bout de la fidélité, même dans l’obscurité. Ce n’est pas parler plus fort. C’est tenir plus profond.
Être radical, c’est vouloir agir sans trahir.
Ce n’est pas convaincre à tout prix. C’est habiter ce que l’on dit.
Cela suppose une lenteur, un silence, une épaisseur. Le radical accepte d’être incompris, parce qu’il sait que la vérité ne s’impose pas : elle se donne. Il se confronte au réel, mais sans l’écraser ; en ce sens, la philosophie comme discipline de vie est une magnifique école d’humilité…
Le fanatique, à l’inverse, confond foi et certitude, action et domination. Il réduit le réel à son système. Il ne supporte ni nuance, ni contradiction. Il préfère avoir raison que servir la vérité.
Nous revoilà à nouveau chez les adorateurs du totalitarisme, cette épidémie envahissante de l’espace public actuel…
3. La radicalité n’est pas le fanatisme inachevé
On entend souvent que le fanatique est un radical qui serait allé « trop loin ». Ce lieu commun est rassurant, mais profondément faux.
Ce n’est pas l’intensité du radical qui produit le fanatique — c’est l’absence d’approfondissement, de discernement, de lien vivant à ce qui fonde.
Le fanatique n’est pas allé trop loin : il a contourné la profondeur.
Il a sauté les étapes, il a refusé les tensions, il a plaqué une réponse avant d’avoir vécu la question.
Le radical, lui, prend le temps.
Il descend, il doute, il vérifie, il consent à la lenteur du réel.
Il cherche à tenir — pas à gagner.
Le fanatique, au contraire, cherche une issue rapide. Il érige une façade sans fondation, un slogan sans substance, une certitude sans racine. Il préfère l’éclat de l’absolu au travail de la fidélité.
C’est pourquoi le radical accueille la complexité, alors que le fanatique l’élimine.
Le radical tient dans l’incertitude, alors que le fanatique fuit le doute comme une faiblesse.
4.1 Figures à distinguer – quand la radicalité libère, et le fanatisme enchaîne
L’histoire regorge d’exemples. Il suffit de regarder non les discours, mais les vies.
Socrate versus ses accusateurs
Socrate est radical dans sa quête de vérité. Il interroge, doute, reformule. Il désarme les faux savoirs par la patience du dialogue. Il ne force personne à le suivre. Il préfère mourir que de renier cette exigence.
Ses accusateurs sont fanatiques de l’ordre établi. Ce qu’ils craignent, ce n’est pas l’erreur de Socrate, c’est la liberté qu’il incarne. Ils veulent la paix sans la vérité. Alors ils tuent.
Antigone versus Créon
Antigone est radicale dans sa fidélité à une loi plus haute que celle des hommes. Elle agit par conscience, sans orgueil, sans calcul. Elle n’attend ni gloire ni adhésion. Elle demeure, quoi qu’il en coûte.
Créon, lui, devient fanatique de l’autorité. Il confond unité et obéissance, loi et justice. Il absolutise son pouvoir. Et, ce faisant, il détruit ce qu’il croyait protéger.
Alexandre Soljénitsyne versus le socialisme soviétique totalitaire
Soljénitsyne est radical dans son refus du mensonge d’État. Il témoigne de ce qu’il a vécu : le goulag, la surveillance, l’humiliation systémique, la mise à mort systématique des opposants. Il écrit pour réveiller les consciences, non pour convaincre par la force. Il tient sans haine, mais sans compromis. Sa radicalité est intérieure, lucide, inébranlable.
Face à lui, les cadres du socialisme soviétique totalitaire incarnent un fanatisme froid, bureaucratique, méthodique. Ils parlent d’égalité, de progrès, de justice… mais au prix du réel, au prix des vivants, au prix de la vérité. Leur système sacralisé justifie la terreur. Le fanatique d’appareil écrase les hommes pour sauver l’idée.
Soljénitsyne ne répond pas par une autre idéologie. Il appelle à la purification du regard, à la fidélité du cœur, au refus de collaborer avec le mensonge.
Hannah Arendt versus les idéologies modernes
Hannah Arendt est radicale dans sa pensée de la liberté, de la responsabilité et du jugement. Elle distingue, elle éclaire, elle refuse les amalgames. Elle n’absolutise rien. Elle cherche à comprendre, même l’incompréhensible. Sa pensée va à la racine du politique.
Les idéologies totalitaires qu’elle analyse – fascisme, nazisme, stalinisme – sont fanatiques dans leur réduction de l’homme à une fonction. L’individu n’existe plus. Il est instrumentalisé, sacrifié, déshumanisé. La pensée est remplacée par la répétition. La politique par la technique de la domination.
4.2 Radical et fanatique dans nos univers professionnels...
Le manager exigeant versus le chef autoritaire
Le manager exigeant est radical dans sa posture. Il fixe un cap clair, assume des décisions difficiles, tient bon sur ce qui fonde la confiance et la performance de son équipe. Il écoute, il ajuste, mais il ne transige pas sur l’essentiel. Sa radicalité n’est pas dans le ton, mais dans la tenue. Il porte ce qu’il demande, et sa cohérence donne du poids à sa parole.
Le chef autoritaire, lui, confond autorité et pouvoir. Il applique les règles sans nuance, parle de rigueur mais cultive la peur. Il croit que tenir, c’est imposer. Il exige des comportements qu’il ne s’applique pas à lui-même. Son fanatisme n’est pas dans la brutalité apparente, mais dans l’absence de relation vivante à ce qu’il commande. Il coupe les liens pour renforcer le contrôle — et finit par vider l’équipe de toute implication réelle.
Le stratège lucide versus le doctrinaire de l’innovation
Le stratège lucide est radical dans sa façon d’interroger le sens. Il remet en question les habitudes, sans chercher le changement pour lui-même. Il écoute les signaux faibles, discute les évidences, accepte le désaccord. Il prend des décisions tranchées, mais à partir d’un réel longuement travaillé. Sa radicalité n’est pas spectaculaire, mais elle redonne de la direction.
Le doctrinaire de l’innovation, à l’inverse, fait de la rupture un mot d’ordre. Il impose un vocabulaire, une vision, une adhésion. Il n’approfondit pas : il diffuse (vaporise ?). Il prend les objections pour de la résistance au changement. Il instrumentalise la modernité comme un dogme. Sous couvert de transformation, il écrase tout ancrage, toute mémoire, tout recul critique.
Le bâtisseur de culture versus le gardien du dogme
Le bâtisseur de culture est radical dans sa recherche de cohérence. Il ne se contente pas de slogans ou de chartes affichées : il travaille les liens entre valeurs, décisions, comportements. Il interroge les pratiques, ajuste les rituels, met en tension le dire et le faire. Sa radicalité est exigeante, mais ouverte : elle invite chacun à participer à une construction commune.
Le gardien du dogme, lui, transforme la culture en religion d’entreprise. Il impose une identité figée, attend des signes extérieurs d’adhésion, surveille les écarts de langage comme des trahisons. Il confond loyauté et obéissance, conviction et conformité. Son fanatisme est feutré, mais insidieux : il produit du silence, du repli, du faux engagement.
5. Trois repères pour discerner
Lorsqu’on rencontre une parole forte, une posture ferme, une fidélité tranchée, comment savoir si l’on a affaire à une radicalité vivante ou à un fanatisme stérile ?
Voici trois repères fondamentaux :
1. La relation : ouvre-t-elle ou ferme-t-elle ?
2. L’approfondissement : relie-t-elle à ce qui est vivant, ou fige-t-elle dans une abstraction ?
3. L’humilité : garde-t-elle la capacité d’écouter, de se remettre en cause ?
6. La radicalité, aujourd’hui, comme condition de paix
Le monde contemporain redoute la radicalité parce qu’il en a perdu le sens. Il préfère les demi-teintes, les slogans flous, la morale sans tranchant. Mais ce refus de la verticalité engendre le chaos ou le fanatisme.
L’absence de racines crée le besoin d’armures.
La mollesse morale nourrit les violences idéologiques.
Nous avons besoin de radicaux. De vrais. De ceux qui n’exigent rien mais tiennent bon.
Qui ne crient pas, mais tiennent parole.
Qui n’imposent pas, mais incarnent.
En guise de conclusion : revenir à la racine pour ne pas être déraciné
Le radical s’enracine dans la vérité, même si elle dérange.
Le fanatique érige une forteresse pour fuir le réel.
Le radical approfondit et cherche.
Le fanatique se durcit et se ferme.
Le radical résiste sans haïr.
Le fanatique domine sans aimer.
Alors oui, il est urgent d’apprendre à discerner, et nos articles Les mots ont un sens sont une modeste contribution.
Oui, osons le dire, il est temps de retrouver la fierté d’une radicalité juste, humble, incorruptible.
Non pas contre l’autre.
Mais pour ce qui mérite d’être tenu, envers et contre tout.
Sophie GIRARD &
Jean-Olivier ALLEGRE
Philosophe (toujours), consultant (très souvent), veilleur (autant que possible)

Brève méditation sur la violence
La violence ne triomphe pas seulement en frappant, mais en contaminant ; lui résister suppose lucidité, refus de l’escalade et courage d’une parole qui accepte le risque.
Inscription newsletter
Pour ne manquer aucun billet de PARRHESIA, laissez-nous vos coordonnées et votre adresse e-mail. Nous serons ravis de vous compter parmi nos abonnés.