Les problèmes insolubles et la valeur de chacun
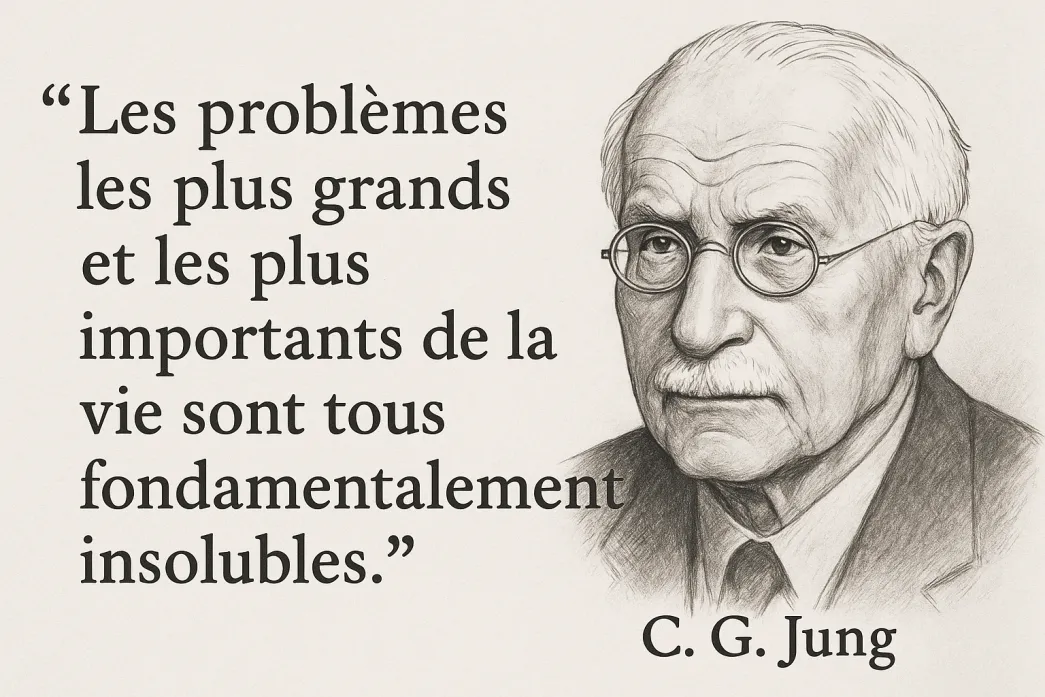
« Les problèmes les plus grands et les plus importants de la vie sont tous fondamentalement insolubles », écrit Carl Gustav Jung.
Dans le monde professionnel, cette affirmation heurte. Nous vivons dans un univers où la recherche de performance s’accompagne d’une exigence de maîtrise (quasi absolue voire religieuse) : un problème doit avoir une solution, une difficulté doit être réglée, un processus doit garantir la répétabilité du résultat, et les objectifs doivent être systématiquement atteints. Ce qui n’est pas « sous contrôle » relève de l’inacceptable.
La promesse illusoire du monde maîtrisé
Or la complexité échappe à cette logique. Elle ne se dissout précisément pas dans une solution définitive. Chaque tentative de résolution fait surgir de nouveaux imprévus et défis. Les environnements complexes fonctionnent par transformations successives et simultanées, non par effacement des problèmes. C’est pourquoi la complexité dérange profondément : elle déjoue la (fausse et illusoire) promesse rassurante d’un monde contrôlable, donc contrôlé.
Une exigence qui nous oblige
Est-ce grave et démotivant ? Nullement. Bien au contraire. Car cette situation nous oblige – au sens noble du terme – à adopter une posture différente. Elle nous oblige à coopérer, puisque nul ne peut, seul, embrasser la totalité du réel. Elle nous oblige à reconnaître la valeur de chacun, non comme un supplément d’âme, mais comme une valeur unique et (potentiellement) décisive. Elle nous oblige surtout à prendre conscience de nos propres forces et de nos compétences, car ce sont elles, et elles seules (à titre individuel et collectif), qui permettent de traverser l’incertain.
Pourquoi le monde professionnel fuit la complexité
C’est précisément ici que se situe la tension avec le monde professionnel. Face à la complexité, beaucoup d’organisations choisissent la fuite en avant : elles simplifient à outrance, elles standardisent, elles empilent les procédures comme si la réalité pouvait se réduire à un mode opératoire industriel (ce qui ne signifie en aucun cas qu’il ne doit pas y avoir de process…). Mais la complexité ne se laisse pas domestiquer par des procédures. Elle ne se franchit que grâce, par et avec la valeur des personnes. Autrement dit, ce qui fait la différence dans un environnement complexe, ce n’est pas le dispositif, mais la qualité singulière de chacun ; et ça, dans le monde pro actuel, c’est juste insupportable, car non maîtrisable…
L’humain au centre, irréductible et fécond
Or cette donnée-là n’est ni maîtrisable ni quantifiable. Elle échappe aux tableaux de bord et aux KPI. Elle résiste à toute tentative de réduction technique. C’est précisément pour cette raison que la complexité dérange : elle remet au centre ce que l’on s’efforce trop souvent de reléguer à la marge – l’humain, dans sa richesse et sa profondeur, et par effet de bord, le management et la qualité du management et des managers…
Une leçon toujours actuelle
Voilà pourquoi la citation de Jung nous bouscule encore aujourd’hui. Les problèmes les plus grands ne se résolvent pas. Ils nous obligent à grandir, à coopérer, à reconnaître la valeur des personnes. Et c’est en acceptant cette exigence que les organisations peuvent trouver, non pas des solutions définitives, mais des chemins vivants et féconds dans l’incertain…
« La complexité n’appelle pas des process, elle appelle des personnes. »
Sophie GIRARD &
Jean-Olivier ALLEGRE
Philosophe (toujours), consultant (très souvent), veilleur (autant que possible)
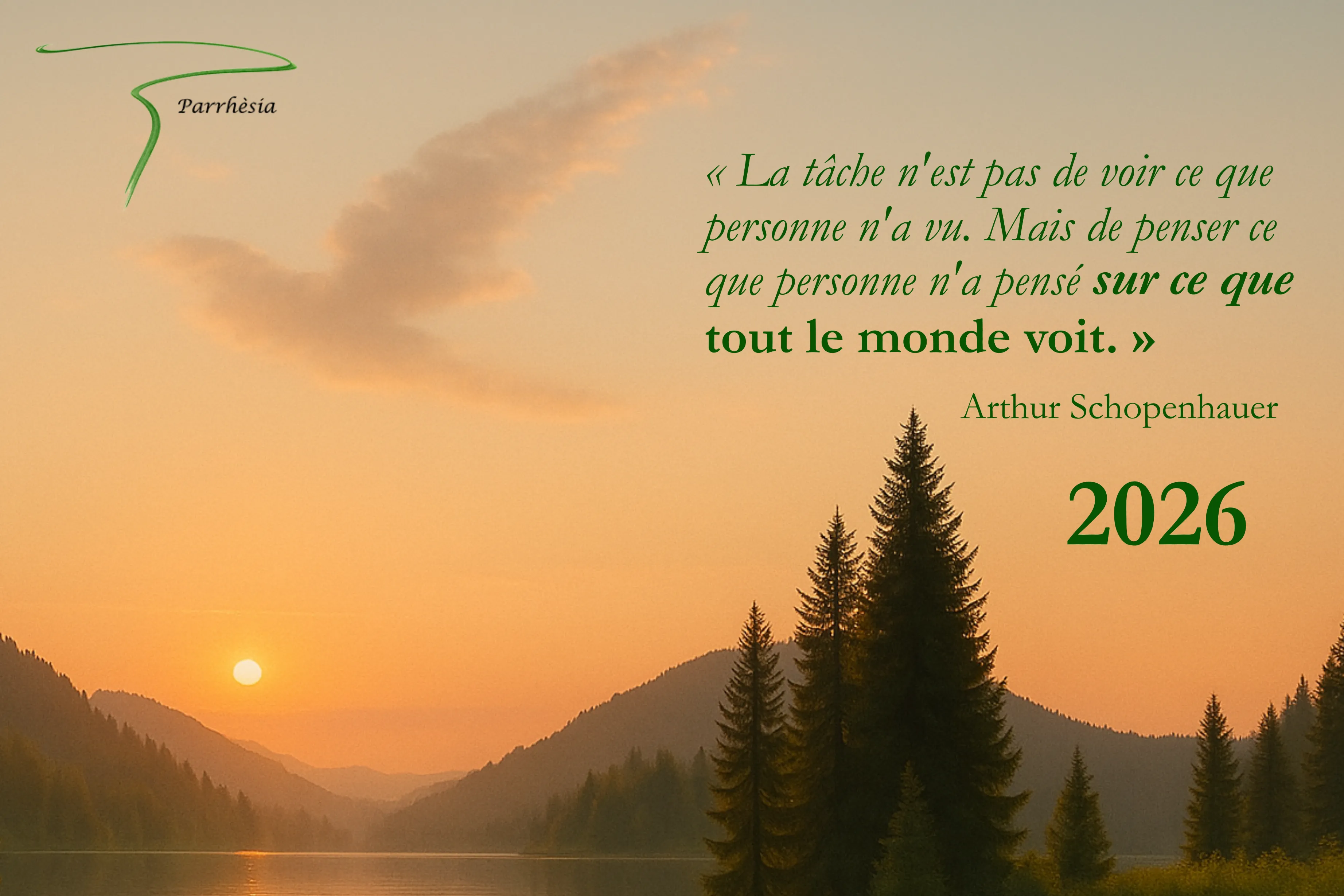
2026 : La Parrhèsia va-t-elle disparaître ?
Une entreprise, une pratique : dire vrai pour tenir la performance.
Un défi majeur (impossible ?) en 2026 !

L'autorité et ses démesures 2/2
De la dictature qui s’installe sous prétexte d’urgence jusqu’au totalitarisme qui prétend refaçonner l’homme lui-même, ce second épisode poursuit la généalogie des démesures du pouvoir — et s’interroge sur ce qu’il reste d’humain quand l’autorité oublie qu’elle doit servir.
Inscription newsletter
Pour ne manquer aucun billet de PARRHESIA, laissez-nous vos coordonnées et votre adresse e-mail. Nous serons ravis de vous compter parmi nos abonnés.
